Alliaire officinale : poumons, détox, plaies et problèmes de peau : (abonnez-vous au podcast ici)
L'alliaire, une plante de la famille des moutardes que l'on trouve très facilement dans tous les pays. Je suis super content de vous en parler parce que vous allez voir que sous sa petite allure de plante comestible, très discrète, elle a certaines propriétés qui pourraient bien vous surprendre. Vous apprendrez à la reconnaître assez facilement si vous faites des sorties en nature avec des associations de reconnaissance de plantes comestibles, vu qu'on l'apprécie aussi pour ses propriétés gustatives.
Mais aujourd'hui, on ne va pas parler des quelques feuilles d'alliaire qu'on peut mettre dans le sandwich lorsqu'on fait une randonnée, on va parler de l'alliaire en tant que plante médicinale.
J'ai bien peur qu'on l'ait un peu reléguée dans le tiroir des plantes oubliées. Et nous, ces vieux tiroirs, on les adore, ils sont pleins de petits trésors. Donc on va les ouvrir.
Botanique
Tout d'abord un peu de botanique. L'alliaire (Alliaria petiolata) est une plante bisannuelle de la famille des brassicacées. En général, vous allez la trouver dans les lieux frais, humides et ombragés.
Elle a une tige dressée, des feuilles en forme de cœur. Elle fait de petites fleurs blanches typiques des brassicacées : 4 pétales, 4 sépales, 6 étamines, dont 2 plus courtes que les autres. Les fruits sont en forme de silique, c'est-à-dire de petites gousses qui contiennent les graines. Et puis surtout, ce qui va nous aider à reconnaître la plante, c'est son odeur d'ail qui en fait l'une des plantes sauvages comestibles les plus appréciées aujourd'hui.
C'est une plante considérée comme envahissante dans certains pays. Et franchement, depuis que j'ai lu le livre de Thierry Thévenin sur les plantes du chaos, je me dis que bien évidemment, elles sont là pour quelque chose, elles ont un rôle à jouer. Il n'y a pas d'action malicieuse de la part d'une plante pour venir envahir un écosystème. Elles viennent remplir un vide que nous avons créé à cause de notre industrialisation à outrance.
Et d'ailleurs, j'ai trouvé une étude sur le sujet. Références à la fin de l'article comme d'habitude. C'est une étude américaine de 2008. Il faut savoir qu'en Amérique du Nord, au Canada par exemple, l'alliaire est classée comme très envahissante. Apparemment, elle a été importée en Amérique du Nord au début des années 1800 pour être utilisée comme plante comestible. Le gouvernement Canadien la considère comme menaçante de certaines espèces végétales comme le ginseng américain (Panax quinquefolium) ou le trille.
Pour être clair, je ne connais rien de ce dossier, et donc je ne me permettrai pas de dire ce qu'il faut faire ou pas. Mais juste pour rajouter mon petit grain de sel. Donc retour à cette étude. Les chercheurs ont analysé la diversité fongique du sol, et comme vous le savez peut-être, ces petits champignons du sol sont extrêmement importants pour la santé d'une forêt. Les chercheurs ont aussi analysé la disponibilité des micronutriments du sol et ils ont vu que là où pousse l'alliaire, le sol est plus riche en azote, potasse, calcium et magnésium.
Ils ont aussi constaté que les feuilles d'alliaire permettent aux feuilles des arbres de se décomposer plus vite et donc au sol de se renouveler plus vite. La conclusion des chercheurs ne va pas vous surprendre : la plante crée probablement un environnement plus bénéfique à son expansion. Oui d'accord, mais est-ce que cet environnement ne serait pas aussi bénéfique aux arbres de la forêt ?
Bon, là encore, avant de m'écrire et de me dire "j'habite au Canada et je connais le dossier et vous dites n'importe quoi" - mon but ici n'est pas de nier la métamorphose de nos écosystèmes et la disparition de certaines espèces. Mon but est d'ouvrir la discussion, de prendre les choses sous une nouvelle perspective et de se dire - et si le rôle de l'alliaire était en partie bénéfique ici ? Je vous invite à lire le livre de Thierry Thévenin pour explorer cette perspective sur les invasives plus en détail.
Alliaire, deux utilisations clés
On parle maintenant des utilisations de l'alliaire. Ses utilisations médicinales spécifiquement. D'abord, on va faire quelques révisions. Oui, un peu comme à l'école, sauf que je ne punirai personne, vous n'aurez pas à copier "Alliaria petiolata" 200 fois avec un stylo plume !
On va réviser en fonction de la famille à laquelle l'alliaire appartient, et en fonction des constituants qu'elle contient.
La famille, c'est celle des brassicacées, famille des moutardes. Les constituants, du moins ceux que l'on connait le mieux et qui semblent être responsables en grande partie de l'action de la plante, ce sont les glucosinolates. On a déjà parlé de tout ça dans l'épisode sur la fausse roquette, dans l'épisode sur le radis noir, etc.
Et on avait dit quoi ? On avait dit que ces constituants soufrés ont une action :
- Expectorante - donc sphère pulmonaire ;
- Et détoxifiante du foie.
Pour l'action expectorante, les constituants en question pénètrent en circulation sanguine, sont relâchés au niveau des bronches et vont liquéfier le mucus, le désinfecter, permettre une meilleure expectoration.
J'aime beaucoup le terme utilisé par Cazin ici. Est-ce que vous connaissez ce dénommé François-Joseph Cazin ? Il a été l'un de nos médecins de campagnes les plus connus dans les années 1800, un grand connaisseur et porte-parole des plantes médicinales en son temps. Et il emploie le terme "incisif" pour l'alliaire. Et c'est vrai que lorsqu'on la dose bien, sous forme d'infusion des feuilles fraiches par exemple, elle a cette énergie chaude, incisive… asséchante aussi.
Donc lorsqu'on a une condition froide, chronique, et humide des bronches, on va y penser. D'ailleurs, Cazin explique qu'il en fait bon usage lorsqu'il y a expectoration chronique, donc on n'est plus dans l'aigu ici. Peut-être qu'il y a eu une infection il y a quelque temps, on en est sorti, mais là il reste une toux grasse et on a du mal à s'en débarrasser.
Il en parle aussi dans l'asthme humide avec cette hypersécrétion chronique. Donc là encore, si condition chronique des bronches, c'est-à-dire condition froide, et humide, c'est-à-dire avec production de mucus, on pense à l'énergie réchauffante et asséchante de l'alliaire. Pour ramener la circulation et pour aider à expectorer.
Pour l'action détoxifiante du foie, je vous ai déjà expliqué que ces glucosinolates (ou du moins leurs métabolites, c'est-à-dire les substances qui vont être fabriquées à partir de ces glucosinolates), vont intervenir dans la phase 2 de la détoxification hépatique. Ils vont rendre cette phase plus efficace. Et dans une période pendant laquelle notre foie doit métaboliser de plus en plus de substances étrangères, et que dans la phase 2... c'est là qu'on veut éviter les bouchons si vous voulez, eh bien c'est une action absolument essentielle.
Alors ici, il faut surtout aller chercher les glucosinolates alimentaires et se mettre pour objectif de prendre un peu de ces substances mais régulièrement. C'est pas une intervention qu'on va faire 1 fois toutes les 2 semaines à fortes doses par exemple. Un peu, régulièrement. Un peu de fausse roquette dans ma salade, un peu d'alliaire avec mes crudités, un peu de bourse à pasteur, un peu de radis noir, etc.
Application externe de l'alliaire
Quelque chose qui est très intéressant avec l'alliaire, c'est qu'on retrouve une utilisation externe dans pas mal d'ouvrages en fait. La plante a une réputation d'antiputride, c'est-à-dire qui empêche la putréfaction des chairs. Dit d'une manière plus simple, on pourrait parler de propriétés antiseptiques et qui aident une plaie à se réparer.
Bien évidemment, en fonction de l'avancement d'une plaie, n'allez pas essayer ceci à la maison et allez consulter un médecin.
D'ailleurs, je vais vous citer Cazin ici, là encore ne faites pas ça à la maison s'il vous plait. "J'ai employé avec succès son suc sur des ulcères sordides et gangréneux. Un vaste ulcère de cette nature existait à la partie externe de la jambe droite d'un enfant de dix ans, et avait l'aspect et la fétidité de la pourriture d'hôpital (...) Le suc d'alliaire appliqué avec de la charpie, et continué pendant 15 jours, combattit la putridité, détergea l'ulcère, procura une suppuration de bonne nature, et amena une cicatrisation favorisée, à la fin, par l'application du vin miellé".
Incroyable pour une plante qu'on croise si souvent en nature. Et notez ici la finesse du médecin de campagne qui travaillait sur des cas très avancés uniquement avec les plantes. Et l'application d'une préparation à base de miel à la fin, le miel qui a, lui aussi, tant de vertus.
Chez Valnet, on voit un mélange moitié alcoolature d'alliaire, moitié teinture de bédégar. Vous savez la galle de l'églantier, cette espèce de boule poilue qu'on trouve sur certains églantiers et qui est due à la piqure et la ponte d'un insecte ? C'est ça, le bédégar. Donc on peut en faire une teinture. Et on mélange alcoolature d'alliaire et teinture de bédégar (je vous rappelle que le terme "alcoolature" désigne une préparation faite à partir de la plante fraîche au passage, l'alliaire se manipule surtout à l'état frais). Ensuite on utilise une cuillère à soupe de ce mélange pour 100 g de sérum physiologique. Valnet nous dit d'appliquer en lavage des plaies torpides et suppurantes, des escarres, des ulcères de jambes.
Henri Leclerc, un autre fameux médecin phytothérapeute français, l'a utilisée pendant la campagne de l'Yser, qui est une série de combats qui se sont déroulés durant la 1ʳᵉ guerre mondiale. Grâce à l'alliaire, il a pu accélérer les cicatrisations, diminuer la suppuration, accélérer la réparation. Il faisait des lavages avec de l'eau bouillante et 10% d'alcoolature d'alliaire. On parle ici de blessures dans les tranchées ! On ne parlait pas de la petite égratignure !
On voit aussi des utilisations pour les douleurs rhumatismales ou les douleurs musculaires, les problèmes inflammatoires de peau de type eczéma, dermatose. En lavage ou en cataplasmes de la feuille fraîche.
Utilisation des graines d'alliaire
On parle maintenant de la graine. On voit que les graines sont rubéfiantes. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire qui ramène la circulation à l'endroit où on a appliqué la substance, comme si on s'était frotté très fort à cet endroit et que ça devient rouge. Pourquoi ramener la circulation en surface ? Pour soulager une congestion sanguine en profondeur. Donc le sang s'est accumulé dans une zone profonde et on veut disperser temporairement cette congestion. Donc on va faire un appel en surface.
Un exemple : lorsque les poumons sont très congestionnés lors d'une bronchite, on va appliquer une substance rubéfiante sur la poitrine pour décongestionner l'intérieur. Eh oui, c'est le rôle du fameux cataplasme à la moutarde. Sauf que là, plutôt que d'utiliser un mélange graines de lin et graines de moutarde, on pourrait utiliser un mélange graines de lin et graines d'alliaire. Cazin nous dit tout de même que les graines d'alliaire sont moins rubéfiantes que les graines de moutardes, donc faudrait probablement mettre un peu moins de graines de lin et un peu plus de graines d'alliaire, par exemple 40/60 au lieu de 50/50.
Graines en poudre inhalées
Dans le passé, on voit l'utilisation des graines broyées en inhalation, pour dégager les sinus. On ramène la circulation vers les muqueuses nasales, ce qui va provoquer une liquéfaction du mucus. En plus de ça, ça va déclencher le réflexe d'éternuement, qui est là pour dégager un corps étranger. Donc ça va avoir un effet d'évacuation et de nettoyage.
Et ça, c'est quelque chose qu'on utilisait souvent dans le passé pour dégager cette partie haute des voies respiratoires. Bien sûr, une habitude qui s'est complètement perdue.
Et ça me fait réfléchir, je me dis… est-ce qu'il n'y aurait pas une valeur à rétablir ce genre de petits gestes justement. On voit l'utilité du nettoyage du nez, des sinus dans certaines traditions. Le Jala Neti en médecine ayurvédique par exemple. Dans certains peuples premiers on voit l'utilisation de préparations à base de tabac pour ouvrir les voies respiratoires, mais plus que ça aussi, pour purifier, pour ouvrir l'esprit.
Je vais vous raconter ma petite histoire à ce sujet. Il y a quelques années, j'étais à un colloque sur les plantes médicinales avec des intervenants qui venaient de tous les continents. C'était à Boston sur un campus universitaire... un vieux campus, très joli. Et on était dans des dortoirs, du moins ceux qui voulaient. J'ai pu faire connaissance de certains de mes compagnons de chambre. Et mon voisin était un ethnobotaniste qui vit au Costa Rica, grand connaisseur des médecines traditionnelles locales, il a écrit ce magnifique livre "Rainforest Medicine".
On a beaucoup parlé de certaines plantes, en particulier de l'utilisation du tabac. Et il m'a dit tient, si tu veux essayer, j'ai une préparation liquide à base de tabac qu'on utilise pour dégager l'esprit, tu mets un peu de liquide dans la paume de ta main, tu inhales. Donc moi, comme d'habitude, j'y suis allé franchement, et là pendant quelques secondes, j'ai cru qu'il y avait un incendie dans les étages supérieurs de ma tête. Donc quelques secondes difficiles, et ensuite, effectivement, une grande sensation de clarté et d'ouverture.
Je referme cette parenthèse. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde devrait sniffer du tabac ni des graines d'alliaire, ce n'est pas quelque chose que je fais personnellement. Mais je me pose la question. Si cela faisait partie de certaines traditions, n'y aurait-il pas quelque chose à explorer ici… je laisse la question ouverte car à ce stade, je n'ai pas de conclusion, mais c'est quelque chose que je vais rechercher plus en détail.
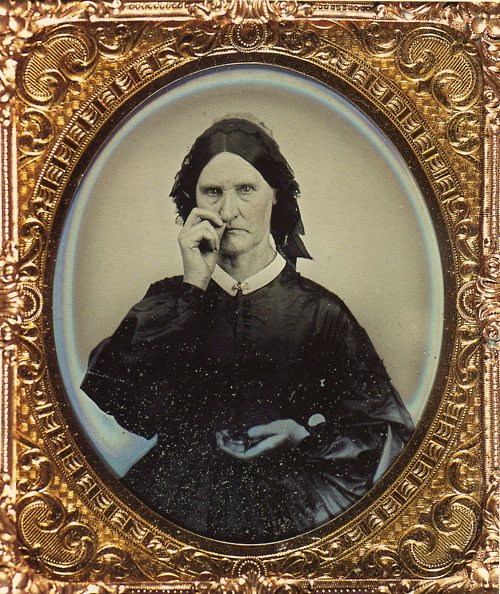
Formes et quantités
En ce qui concerne les formes et quantités.
On voit que c'est surtout la forme fraîche qui était utilisée et on comprend facilement pourquoi. Dès que vous avez des plantes qui contiennent ces constituants soufrés qui sont très volatils, qui peuvent s'échapper de la plante, vous allez beaucoup perdre au séchage. Donc pour ma part, c'est une plante que j'ai toujours utilisée fraîche.
En revanche, je voulais vraiment comparer la version sèche avec la version fraîche. Mais je n'en ai jamais fait sécher, je n'ai pas de stocks à la maison. Donc j'ai essayé d'en commander en herboristerie pour pouvoir comparer. Eh bien impossible d'en trouver ! Bien sûr je n'ai pas regardé toutes les boutiques, mais les principales que je connais n'en ont pas. Donc à ce stade je ne pourrai pas vous faire une comparaison, il va falloir attendre la prochaine fois que j'en ramasse.
Pour les quantités sous forme d'infusion, on voit chez Valnet 20 g de feuilles par litre. Il ne précise pas si c'est frais ou sec. Logiquement, c'est du frais. Chez Fournier on voit entre 20 et 60 g par litre, une fourchette assez grande, je vous l'accorde.
On peut aussi utiliser la teinture faite à partir de la plante fraîche, qu'on appelle aussi alcoolature. Pour les quantités, personnellement je ferais probablement entre 30 et 60 gouttes par prise, en fonction du contexte. Par exemple, pour une situation respiratoire, je ferais une 30'aine de gouttes rajoutée dans une infusion de plantes aromatiques et de résineuses. Donc plutôt en combinaison avec d'autres.
Pour la forme lavage et compresse, Leclerc recommande de faire bouillir de l'eau puis de rajouter 10% en alcoolature d'alliaire. Valnet recommande les feuilles fraiches broyées en application sur les dermatoses, ou les feuilles mâchées et rejetées ensuite.
La forme infusion en gargarisme, je cite Valnet : "affermit les dents branlantes, fortifie les gencives, prévient la carie".
Précautions
Pour les précautions d'emploi : aucunes connues.
En revanche, si vous ramassez l'alliaire pour la consommer comme aliment, n'oubliez pas les risques d'échinococcose en fonction des zones de ramasse.
Eh bien voilà, pour une petite plante très commune et dans certains endroits, considérée comme "envahissante", ça fait pas mal de propriétés. J'espère que vous apprendrez à la reconnaître et à l'utiliser d'une manière judicieuse.
Merci et à bientôt pour un prochain épisode !
Références
Rodgers, V.L., Wolfe, B.E., Werden, L.K. et al. The invasive species Alliaria petiolata (garlic mustard) increases soil nutrient availability in northern hardwood-conifer forests. Oecologia 157, 459–471 (2008). https://doi.org/10.1007/s00442-008-1089-8


















